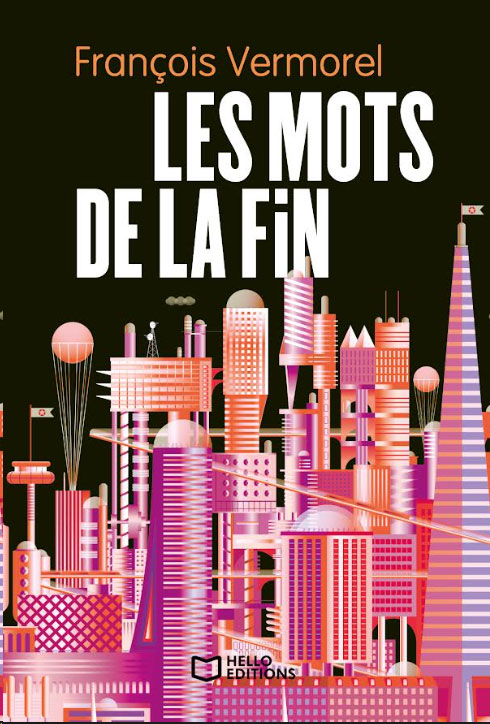J’ai grandi à Lille. Ce n’est pas là que je suis né mais j’y ai passé les premières années de ma vie, de mes sept ans à mes vingt trois ans, en gros. De cœur, je suis Lillois. Quand j’y retourne, je suis à la maison. J’ai l’impression de connaître chaque façade et chaque pavé. Alors même que le temps a passé et que je n’y connais plus grand monde.
Depuis l’enfance, je suis passionné de lecture. S’il y a eu une constante dans le déroulé de ma vie, c’est bien celle-là. Mes premiers souvenirs de livres sont désormais fort brumeux. J’ai en mémoire la couverture terrifiante – et pas franchement progressiste – des Schtroumpfs noirs. Celle, plus ringarde, des aventures de Jojo Lapin. Et puis surtout – mais j’étais déjà plus âgé – la collection des “Contes et légendes” et leur absurde reliure pseudo dorée qui se délitait avec l’usure.
C’est assez logiquement et sans me poser de questions que j’ai entrepris des études de lettres, puis que je suis devenu professeur de français. Mais l’aventure n’a pas duré. Des questions, en fait, il aurait mieux valu que je m’en pose quelques-unes. Et c’est un peu sans transition que je suis sorti d’une voie toute tracée vers le tourbillon d’une vie plus incertaine.
L’époque, il faut le dire, s’y prêtait plutôt bien. On était au tournant du millénaire et le bouillonnement d’internet offrait des opportunités aux “profils atypiques”, selon le langage désolant des RHs. Je me suis découvert un peu plus débrouillard que je le pensais. Après différentes pérégrinations, j’ai atterri à Paris où j’ai commencé une nouvelle carrière, dans le web et dans l’enseignement privé en arts et design.
Il devient difficile de se rappeler l’atmosphère qui régnait à cette époque. Mais pour faire bref, la perspective de connecter par les réseaux des dizaines, des centaines de millions d’individus instruits vivant partout sur la planète laissait entrevoir des avenirs fabuleux. Une nouvelle Renaissance, à la fois technique et artistique mais également spirituelle et politique. Bilan, vingt-cinq ans plus tard : des marketeux qui compilent des données, des caméras de vidéo-surveillance boostées à l’IA et des adolescents neurasthéniques qui scrollent sur Tik Tok. Quand je repense à mes illusions, j’étais à l’époque fort naïf et politiquement très insuffisamment formé. Mais j’étais jeune et je pouvais rêver à des lendemains chantant. En 2024, mes étudiants n’ont pas la même chance.
J’ai commencé à m’engager, en pointillé. Un peu dans une association franco-vietnamienne, un peu dans une autre… Les temps politiques se durcissaient. Aux espoirs relatifs de la période Jospin avec ses réductions de temps de travail avaient succédé le déprimant second mandat de Chirac et, plus inquiétant, l’éructant Sarkozy. A l’international, l’élection et la réélection de Bush Junior donnaient un coup d’arrêt aux fantasmes puériles d’une mondialisation heureuse. Pour moi, j’ai senti que le temps d’un engagement plus solide était venu.
Au crépuscule du Sarkozysme, en 2012, l’alternance socialiste paraissait aussi inéluctable que sans relief. J’ai dû à un hasard de rencontre et à une fort opportune tribune publiée sur Rue89 de m’engager pour la première fois en politique. J’ai rejoint le Parti Pirate qui bénéficiait à cette époque d’une visibilité éphémère.
M’y avait amené la conviction que notre système politique est à la fois obsolète et irréformable. La promesse pirate était celle d’une refonte complète de la démocratie et d’un renouveau des prises de décisions collectives :les évolutions techniques permettaient de sortir la démocratie directe de l’ornière organisationnelle des assemblées générales roboratives et souvent biaisées. Au Parti Pirate se retrouvaient toute une mosaïque d’individus – par ailleurs pas forcément toujours fréquentables – venant d’idéologies extrêmement variées. Et que des processus démocratiques innovants étaient supposés faire travailler ensemble. C’était un joyeux bordel, incroyablement vivant, et pendant des années j’y ai milité en espérant qu’il pourrait être le départ de quelque chose.
Sauf que non. De clashs en engueulades, d’élections foirées en rassemblements avortés, le nouveau parti s’est rabougri en un groupuscule. Et où régnait une violence d’autant plus absurde qu’aucun résultat politique ne pouvait plus en émerger. A la suite d’une énième prise de bec, le parti s’est scindé. Et j’ai fait mes valises.
Entre temps, j’étais devenu papa. Mes responsabilités professionnelles avaient fortement évolué. Mon temps se réduisait, je courais après et s’il était hors de question de cesser de m’engager, j’avais désormais le désir d’un peu de pragmatisme. Après la quarantaine on commence à avoir un peu envie de résultats. C’est alors que j’ai rejoint EELV, pour une campagne municipale ahurissante, shootée en fin de premier tour par la crise du COVID.
C’est aussi à cette période que j’ai commencé à écrire mon roman. J’ai toujours un peu écrit, sous des formes ou sous d’autres et j’ai toujours énormément lu. Mais j’ai toujours considéré la littérature comme un jardin privé – quelque chose de totalement déconnecté à la fois de ma vie professionnelle, de ma vie militante et même de ma vie familiale et sociale. Un espace ailleurs, à part, rien que pour moi. Arrivé au milieu de la quarantaine, j’ai senti qu’il était temps de recoller les morceaux. Et je dois à la lecture de Pablo Servigne une forme de révélation : il faut écrire sur les sujets qui comptent. Il faut écrire quand on a quelque chose à dire. Et rien, pour le papa que j’étais devenu, n’est plus crucial et plus important à exprimer que l’angoisse de la marche du monde et la possibilité de l’effondrement civilisationnel.
Je suis un type qui aime les histoires. Je m’en suis d’ailleurs peut-être un peu trop raconté à moi-même. Adolescent, jeune homme, je jouais aux jeux de rôles. J’avais la fibre du conteur qui ne m’a jamais lâché. J’ai réglé mon réveil à 5h ou 6h du matin pour écrire deux heures avant d’aller au boulot. Mon travail d’écriture est parti d’abord dans tous les sens. Des éditeurs m’ont fait remettre le travail sur l’établi. Alors j’ai resserré le récit sur une trame plus classique : un polar d’anticipation dystopique où deux personnages, deux parisiens fort banals vivent leurs vies au moment de l’Effondrement écologique global de la planète.
La dernière étape de tout le processus, ça a été de trouver un titre : “Les mots de la fin”. C’est plutôt efficace mais pas très original. Et surtout, un peu trop dramatique alors que le roman, en fait, est plutôt drôle. Je l’ai contrebalancé d’un sous-titre “Argent, Amour, Apocalypse.” que j’aime assez. C’est un octosyllabe bien balancé et qui a le mérite de signifier que mon bouquin ne se prend pas trop au sérieux.
Quelle que soit sa réception future, ce livre aura été une étape dans mon engagement. Je crois fondamentalement au pouvoir des mots. Je sais qu’ils peuvent changer le monde. Et je pense qu’on a besoin d’histoires, besoin de s’en raconter et d’en lire. Ne serait-ce que pour savoir dans laquelle on veut vivre. Ou pas.